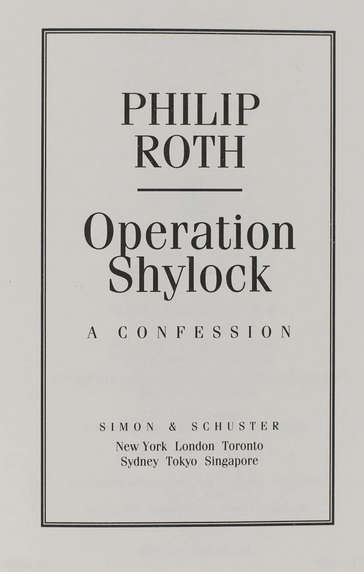
J’entre en matière sans circonlocutions : il y a deux ans, j’ai fait une dépression monumentale. Ça n’était pas l’énième occurrence d’un phénomène psychologique bien connu, c’était radicalement nouveau et terrifiant. Pourtant Dieu sait que j’ai vécu des choses difficiles de bonne heure. Mais pour cette raison même je me sentais immunisée ; comme si j’avais vu le fond des choses et que, tout en ne laissant pas d’être continûment paranoïaque à l’idée de replonger un jour ou l’autre, je m’étais, pendant quinze ans, sentie invulnérable à une déchéance de telle ampleur.
Ce n’était pas quantifiable avec les mesures ou critères qui étaient les miens à l’époque : ça n’était pas plus douloureux, c’était tout simplement inattendu de brutalité ; une douleur d’une qualité inconnue. Ou connue, peut-être, mais pas sur un mode immédiatement conscient, de telle sorte que j’aurais pu y voir une reviviscence du passé lointain. Je ne savais pas exactement d’où ma douleur venait, ce qui la rendait si profonde, terrassante et abrasive. Son origine comme sa densité m’échappaient, passaient mes forces de rationalisation. C’est consubstantiel à la dépression : l’impossibilité de la circonscrire, de l’embrasser par la pensée ; elle n’a ni contours ni sens. La dépression est informe, un magma inextricable de sensations archaïques, primitives, qui se trouvent même en-deçà du spectre affectif normal. C’est infra rationnel et infra émotionnel. La douleur dépressive est humiliante parce qu’elle met à mal toutes les catégories intellectuelles habituellement mobilisées pour donner une intelligibilité à l’expérience : elle est une explosion de paradigme, mais n’ouvre évidemment pas aussitôt sur un nouveau modèle explicatif et existentiel.
C’était pourtant bien la reviviscence du passé ; mais d’un passé perdu. Je ne parvenais pas à sentir que je revivais mon passé ; j’en avais seulement l’intuition «vide». Ce passé, cette douleur, je les avais tellement reniés que je m’étais rendue incapable de les faire miens à l’heure où ils me revenaient en pleine gueule.
Le propre de la dépression est sans doute de surgir sur fond de coupure avec le passé : elle procède d’une division ou scission du soi, et ne peut apparaître indépendamment de cette fracture. Par suite, elle est une déconstruction systématique de l’histoire « élaborée » par un sujet au-dessus de son histoire propre : la légende, l’auto-mythification, la narration subjective qui fonctionne comme rempart à la folie, la souffrance, la contingence. Ce sont les strates supérieures de la subjectivité qui sont attaquées par les symptômes dépressifs.
Je n’entends pas ici des éléments superficiels, mais tout ce qui est constitutif de l’idée de «moi» depuis plusieurs années, et qui atteint, dans la crise qu’est l’éclatement dépressif, ses limites, bascule dans la caducité. Seulement l’individu dépressif n’a pas une claire conscience de ce qui est détruit et de ce qui est intact : dans le vécu immédiat, le délitement semble total.
Je parlais de «passé perdu». L’esprit, en effet, ne peut pas produire ex nihilo de telles visions d’horreur, et pensées infernales qui vous harcèlent en boucle. Il y a une symptomatologie commune à tous les épisodes dépressifs dits majeurs, mais le concept de «dépression» renvoie à des expériences psychopathologiques extrêmement différenciées, irréductibles. Je n’ai pas retrouvé dans les récits de dépressifs ce que j’avais vécu. Dans les romans de Philip Roth, heureusement, j’ai lu des passages de génie, me frappant d’autant plus par leur acuité et familiarité que l’auteur était bien plus âgé que moi : pourquoi avait-il fallu que je me rende cela accessible à 27 ans? Et où allais-je trouver l’énergie de survivre à cinquante années de plus une fois mes lectures de Roth avancées, si j’avais déjà épuisé une expérience aussi «conclusive»?
Bref, Philip Roth m’a aidée à tisser mon chaos dépressif de mots, et ce dans la durée : dans sa forme «évolutive». Le marasme dépressif est un poison qui atteint toutes les cellules du corps et le contamine longuement, engendrant une série d’états affectifs et de micro phénomènes psychiques avant de laisser le sujet à une paix relative. Mais on ne régresse pas vers l’état antérieur ; l’épisode est irréversible et créateur de normes sui generis. Aussi le critère ultime de la guérison est-il l’exaltation de cet état même qui est produit par le syndrome dépressif. C’est ce dont la dépression accouche finalement, elle qui semblait la marque d’une irrévocable stérilité. Ce résultat, c’est soi-même ; du moins un certain sens de soi ou ipséité. Cet héritage de la dépression est inestimable.
Pensées récurrentes impossibles à «arrêter», ruminations funestes, épisodes de détresse et épisodes catatoniques, fixations, tristesse immodérée, désir anxieux de mort, anticipation permanente du suicide, crises de larmes, dépersonnalisation, déréalisation, paranoïa chronique, dysmorphisme, etc. La dépression est susceptible de mille mutations : je les saisissais une à une d’un roman à l’autre de Philip Roth. C’est du reste par la dépression que je suis entrée dans son œuvre : Opération Shylock s’ouvre quasiment sur la description magistrale d’un épisode de désintégration psychologique. Dans le roman, le personnage qui vit cette dislocation rapporte une opération ratée du genou comme point de départ de l’effondrement. J’avais moi-même fait une double tendinite du genou droit, mal soignée, quelques mois avant de sombrer pour de bon. À croire que les problèmes de genoux sont la meilleure illustration de la «panne» à laquelle revient, selon Alain Ehrenberg, la dépression – «le déprimé est un homme en panne», écrit-il dans La fatigue d’être soi. Une machine cassée, qui ne peut plus avancer. On est littéralement «sur les rotules», et les rotules finissent par céder.
Avant Philip Roth, j’ai lu Aharon Appelfeld, et la poésie de Yehuda Amichaï. Pas exclusivement ; mais ces trois références occupent une place singulière et émergent sur fond de néant. C’était au cœur de l’épisode dépressif : le noyau dur des cinq premiers mois.
En ouvrant Philip Roth, j’avais déjà fait du chemin – je prends pleinement conscience, en écrivant ce texte, que mon coup de foudre et la voracité avec laquelle je l’ai lu sont tributaires de ma dépression et de la manière dont cet objet, ce thème est pris en charge dans ses romans. Si Portnoy’s Complaint m’a laissée passablement indifférente – je lui trouvais un indéniable brio –, c’était en ce que ce livre de jeunesse ne traduisait pas encore une existence marquée, brûlée par la dépression. À mes yeux il s’y trouve une énergie naïve, un acharnement tout adolescent dans l’existence – dont je pense d’ailleurs que Roth le raille rétrospectivement à travers la figure de Kliman dans Exit le fantôme :
«Je retrouvais là, de façon inattendue, quelque chose de moi à peu près au même âge, comme si Kliman avait imité (ou, ce qui semblait maintenant plus approprié, parodié exprès) la manière que j’avais de foncer bille en tête à l’époque de mes débuts. Tout y était : la sévérité brutale du jeune mâle plein de sève, l’absence totale de doute quant à la justesse de son propos, l’aveuglement né de la présomption et de la certitude vertueuse de savoir reconnaître l’essentiel. Le sentiment d’être mené d’une main de fer par la nécessité. Face à un obstacle, la réaction immédiate de vouloir le réduire en miettes. Ce sont ces jours pleins de bravoure et de panache où vous n’avez peur de rien et où vous ne pouvez qu’avoir raison. Tout vous sert de cible. Vous êtes en position d’attaque. Et c’est vous, et vous seul, qui avez raison. Le jeunot invulnérable qui se croit un homme et qui brûle de jouer un rôle important. Eh bien, qu’il le joue. Il verra bien.»
Par où on voit l’un des traits les plus admirables de son écriture : à l’ennemi, au personnage le plus vil, est toujours rendue une complexité – ici par la projection de soi, si ma lecture est juste – qui s’apparente à un hommage ! Hommage certes empoisonné puisque l’attaque est d’autant plus virulente et imparable qu’elle fait cette faveur à l’adversaire. Bref, dans Portnoy, l’écriture est déjà traversée par une terreur d’exister – par quoi d’autre serait-elle motivée, de toute manière ? – qui tente de s’apaiser par une quête effrénée de sens et d’interprétation des caractères humains – avec la lucidité impitoyable des moralistes –, mais qui croit encore… à la possibilité d’un dénouement heureux. L’écriture rage même de le faire advenir. (Le paradoxe est, bien sûr, que l’écriture porte l’intention de l’auteur bien au-delà d’elle-même et laisse apparaître, dans les dernières pages, une tonalité étonnamment sombre…)
La dépression, quant à elle, est une rage pure, aveugle, sans objet : elle n’est pas orientée vers la moindre résolution. Elle est auto-référentielle et a perdu toute trace de téléologie, même inavouée. Elle n’ouvre sur rien d’autre qu’elle-même. Chez moi, elle se traduisait, en particulier quand j’étais assise à mon bureau, seule, par l’image d’un mur de ciment opaque, « plein » et aveuglant. Un mur qui se dressait devant moi, et sonnait obstinément comme le mot «forclusion», alors que ce terme est un concept bien précis introduit par Lacan dans le champ de l’analyse… Je reliais ce mot, dans mon réseau subjectif de significations, à l’idée d’occlusion. Mais il n’est pas inintéressant de voir que la forclusion est le point d’arrimage de la psychose.
Je redoutais, plus ou moins consciemment, le délitement narcissique, la désintégration subjective propre à la psychose ; comme si la dépression me mettait en contact intime avec l’élément de la folie, et que cet élément menaçait de me gagner entièrement. Comme une vague dans laquelle je pouvais, voire pouvais être tentée de me noyer. La folie exerce un pouvoir de séduction dans ces moments où la douleur atteint des sommets : l’esprit qui raisonne et met «à distance» la perçoit comme un abandon, un laisser-aller attrayant. Le sujet n’aurait plus à se soutenir quotidiennement, à tenir – écrit Celan. À paraître normal, à se composer alors qu’il se sent mort et une somme de décombres. Claude Olievenstein écrit, dans L’homme parano : « La porte, entre la folie et la non-folie, est étroite.»
J’ai pensé : «Voilà, peut-être vais-je finalement devenir folle ; on n’échappe pas si facilement à cette conséquence du passé.» Cela ne me choquait pas, de perdre la tête : ce qui me choquait était de n’avoir pas sombré plus tôt. Ce qui me choquait était d’avoir résisté si longtemps. Que l’effondrement puisse se produire à 27 ans, alors que j’avais été «résiliente», courageuse, si construite et combattive des années durant. Tout ça pour m’écraser pareillement sur mes 20 ans vieillissants ?
Quand j’étais à mon bureau, incapable de relever entièrement la tête tant la pensée du mur m’accablait, je lisais la poésie d’Amichaï. Je ne suis pas vraiment retournée à ces poèmes, mais j’en garde le souvenir marquant de mots écrits dans la vieillesse, sur la vieillesse ; sur la finitude. Sur ce que c’est que de vivre en ayant derrière soi une vie-musée, chargée de souvenirs qui ne sont plus convertibles au présent. Des poèmes décrivant une marche vers la mort ; implacable mais majestueuse ; désorientée mais assurant une «présence» poétique… C’est ce qui rendait cette lecture si étrange pour moi. Composée alors qu’il n’y avait raisonnablement aucun «après» à espérer ; rien qui vienne au secours du poète, sinon son art et une mort assurée. L’écriture qui est à elle-même sa solution ; l’écriture comme remède «performatif» aux conflits existentiels qu’elle orchestre et met en scène, n’est évidemment pas sans parenté avec Philip Roth. Il y a des caractéristiques communes à l’ensemble du corpus qui m’a accompagnée. Je cherchais des auteurs qui faisaient face, ne détournaient pas les yeux.
Le passé ne fournit pas d’enseignement à l’approche de la mort : il est, tout entier, « vie ». Ce qui, de lui, était lié à la mort, s’estompe pour fournir une image rétrospective de vie pure. Toutes les hybridations de la vie et de la mort disparaissaient dans les poèmes que je lisais, à mesure que la mort concrète approchait. C’est en tout cas le souvenir que j’en conserve, sans doute très discutable ! Dans la dépression, aussi, le passé est vie : il apparaît miraculeusement doué d’une énergie propre, motrice, d’un élan liant les instants pour en faire un flux. La dépression n’est que rupture et discontinuité : un instant ne se fond plus dans le suivant mais se découpe péniblement au point de transformer chaque seconde en enfer.
Je trouvais cependant chez Amichaï une émotion caractéristique, que je dirais volontiers «virile». Sa lettre est brûlante de désir ; «rouge-vie». Une sorte de flamme qui jette une lumière rougeoyante sur la vieillesse elle-même. C’est peut-être parce que je pensais à la chaleur de Jérusalem. C’est plus vraisemblablement parce que l’écriture est sensuelle, infusée de langueur. Il y a du chagrin et de la vulnérabilité, mais la dignité du poète dans sa vieillesse est telle qu’elle le rend paradoxalement sage et érotique. Il y a quelque chose de mâle dans cette poésie, si vous me passez le ridicule de l’expression.
Cette sensualité me rendait puissamment à moi-même, autant que possible dans mon caveau, en tout cas. Et ce « caveau » m’a retenue cinq mois : cinq mois de crise massive. Cela définit, dans l’expérience dépressive, la phase où la douleur est néantisante, comme du plomb. Je vivais à l’étroit dans mon corps – dont j’avais appris qu’il avait une lésion cancéreuse ; sorte d’incident déclencheur – et comme sous un ciel bas et noir, menaçant. C’était l’asphyxie ; il y a une perte de familiarité et une sorte de claustrophobie du corps et de soi dans la dépression.
Le pire est le gouffre monstrueux qui sépare le vécu psychique de l’apparaître. Je déployais une quantité folle d’énergie… pour ne pas être, à l’extérieur, le cadavre interne. Pour moi, le jeu social était pure facticité, trucage : une scène sur laquelle je faisais office de moi-même. Où les gens voyaient cette «Margaux » que je n’étais plus, mais qui avait des responsabilités professionnelles et des devoirs incompressibles à honorer. Ma culpabilité était immense, c’est la raison pour laquelle je ne me suis pas arrêtée. J’ai retenu récemment cette phrase, dans un texte de Stéphane Mosès sur «W. Benjamin et la crise de la tradition » : « Dans la Lettre au père, Kafka parle du sentiment de culpabilité sans limites que la tyrannie paternelle avait provoqué en lui et cite à ce propos la dernière phrase du Procès : ‘‘C’était comme si la honte avait dû lui survivre.’’ Pour Scholem, ce sentiment d’infinie culpabilité fait que, représentant symbolique de l’homme moderne, le héros de Kafka vit encore à l’ombre d’une loi depuis longtemps caduque. » La dépression est affaire de système de valeurs : les valeurs du père, par exemple, peuvent être longtemps intériorisées sur le mode du « porteur sain », du virus asymptomatique. À l’occasion d’un concours suffisamment désastreux de circonstances, elles réapparaissent différemment au sujet qui ne trouve plus la force de s’y opposer : c’est l’abdication par sentiment de malédiction. Les valeurs du père ont triomphé à la manière d’un surmoi qui ravalerait entièrement le moi.
Le dépressif a fondamentalement honte de s’effondrer ; mais ce n’est pas tout : il en a peur. Peur de l’issue d’une telle chute dans le vide… N’être pas arrêté, s’évertuer superstitieusement à ne jamais employer le mot «dépression», c’est nier ce qui se passe avec ténacité, dans l’espoir fébrile que cette «mésaventure» puisse encore cesser. Un peu comme aux débuts de la métamorphose de Gregor Samsa : « (…) et il resta couché un moment immobile en retenant son souffle, comme s’il espérait que le calme total allât rendre à toute chose son évidence coutumière.»
J’ai gardé longtemps l’espoir que ça s’arrête, comme une pensée-réflexe. (Une pensée magique de déni de la gravité de l’état : l’admettre serait reconnaître implicitement le chaos interne dont elle n’est qu’un reflet, et le travail titanesque qu’il faudra tôt ou tard engager.) Je me répète : on sort de la dépression quand l’espoir de «retour à la normale » disparaît. Cet espoir n’est pas accidentel ni consécutif ou contemporain de l’expérience dépressive : il en est constitutif. La dépression est un deuil ; on y pleure une «perte» et on se bat avec les dernières forces pour se conserver. J’ai arrêté de fumer le jour même où j’ai appris que j’avais une lésion cancéreuse – qui a, conséquemment, disparu en quelques mois sans que j’aie à subir une opération. J’ai fait deux à trois heures de vélo tous les jours pendant cinq mois pour calmer mes nerfs. Je me levais à des heures indues pour aller au lycée du lundi au vendredi, vivant à Paris et enseignant à Chartres avec un emploi du temps inadapté. Tout ça ne se fait pas sans rage. Je passe sur les détails personnels, relationnels, familiaux qui formaient une conjoncture explosive de portée apocalyptique. À un niveau plus fondamental, mais souterrain, je revivais, sans le savoir distinctement, les cinq années de maltraitance continue que j’ai subies dans l’enfance. J’ai repris ma psychanalyse à l’issue de ces cinq mois.
Que dire des hallucinations qui émaillaient mes journées? Je cite Philip Roth dans Opération Shylock :
«Jour et nuit, j’étais submergé par de pareilles vagues d’hallucinations, pires même parfois, véritables troupeaux d’animaux sauvages que je ne parvenais jamais à arrêter.»
J’étais à ce point persuadée d’être morte que je me représentais des tissus organiques internes putréfiés exhalant des fumées noires, exsudant par les pores de la peau. Dégageant une odeur de nécrose, une odeur de chair brûlée. Le dépressif ne vit pas un effondrement secret, qu’il pourrait se dissimuler à lui-même. Le processus d’auto-dévalorisation (ou autodépréciation) radicale qui y œuvre atteint toutes les couches de l’être : physiquement, l’expérience est avilissante, serait-ce sur un mode strictement paranoïaque. Personne, certes, ne voit. Je ne sais pas ce que je voyais quant à moi, mais ce n’était plus moi. Perte complète de familiarité : comment ne pas songer une deuxième fois à la Métamorphose ? Je voyais un visage fissuré ; flétri, sillonné par des rides précoces. Un visage fendu, coulé dans la douleur. Le visage est abîmé, mais il est aussi terni et sale. De ce même sentiment de souillure qu’évoquent les personnes violées.
Plus globalement, la dépression est une perte de repères. Mais le monde est second : c’est d’abord à soi-même qu’on devient étranger. J’ai dit qu’on pleurait une perte dans la mélancolie dépressive. Freud distingue, dans Deuil et mélancolie, la mélancolie du deuil en disant que le dernier a un objet déterminé quand la première en partage certains symptômes mais demeure sans objet. L’objet est en fait le « soi » lui-même :
« (…) Ce pourrait même être le cas lorsque la perte à l’origine de la mélancolie est connue du malade, lequel sait, à vrai dire, qui il a perdu, mais pas ce qu’il a perdu dans cette personne. Ce qui nous suggérerait par conséquent que la mélancolie porte, en quelque sorte, sur une perte d’objet dérobée à la conscience, à la différence du deuil, dans lequel la perte n’a rien d’inconscient. (…) Dans le deuil, le monde est devenu pauvre et vide ; dans la mélancolie, c’est le moi lui-même. »
Il faudrait cependant distinguer deux niveaux. Le soi avec lequel on désespère de coïncider à nouveau n’est pas le soi profond. Ce n’est pas le soi des couches inférieures de l’être ; mais la personne dans laquelle, bon gré mal gré, on a vécu dix, quinze ans, parfois plus je suppose. Dans mon cas, c’est une individualité que j’avais construite pour «tenir», douée d’une efficace redoutable… pendant quinze ans. Au réveil, à l’hôpital, d’une tentative de suicide à 14 ans, j’avais consolidé cette individualité, loin de m’affaisser dans le désespoir. J’avais été frappée par ma propre ruse, détermination. J’avais ouvert un œil, et aussitôt après la déception d’être encore là – I remember being disappointed I survived, dit Harry Caul dans The Conversation de Coppola –, j’avais décidé de vivre avec ardeur et même de «régner».
C’est cette personnalité de combat qui s’émiette cruellement dans la dépression. Elle ne fait plus le poids devant le retour monstrueux du refoulé. Je ne crois pas que tout dépressif ait à vivre ça : la « panne » fonctionnelle que décrit Alain Ehrenberg ne rime pas nécessairement avec cette résurgence traumatique. Ou peut-être en est-ce toujours un antécédent ? Je ne sais pas, et serais curieuse d’adresser cette question à des chercheurs. Je n’ai pas étudié la dépression en universitaire. Je l’ai vécue et me borne à formuler, deux ans après, une ou deux idées que je ne veux pas laisser filer. Il me faut fixer quelque part mes résidus mnésiques, et quelque chose en moi s’obstine à témoigner. Le témoignage est l’ultime produit de toutes mes expériences : je suis ainsi faite que ce but est premier. Je précise qu’il n’y a aucune prétention littéraire : l’ambition est intellectuelle. Mais cette fois, je n’ai pas le cœur à séparer le discours académique du discours à la première personne. La dépression est idiosyncrasique, irréductiblement subjective : c’est ainsi que j’entends la formuler, et non dans un ensemble de concepts abstraits détachés de leur origine existentielle. Je ne critique évidemment pas cette méthode, qui a par ailleurs toute sa validité, mais la révoque un temps.
Je ne m’étendrai pas interminablement sur ce sujet mais souhaitais clore en reprenant cette double idée de « soi ». J’ai parlé de ma lecture d’Appelfeld sans m’y attarder : je l’ai déjà tellement évoquée à mes proches… Je n’aime pas me répéter comme un perroquet. J’ai ça en horreur. Phobie de la répétition, comme si la pensée s’y était fossilisée : les phrases qu’on répète, comme celles du dépressif, sont «dévitalisées», pour reprendre la belle trouvaille de ma psychanalyste (dont la compétence est hors normes). Appelfeld parle, dans un contexte différent bien sûr, des «mots d’avant»: c’est un thème qui parcourt différents romans. Les mots d’avant sont impropres, parfois obscènes, surtout dérisoires et surannés.
Aharon Appelfeld fut une parole-sœur dans un univers psychologique déshumanisé. Les visions que j’avais étaient bestiales. J’étais précipitée, tous les soirs à partir du moment où je rentrais chez moi et tournais le dos au monde, dans les mêmes pensées obsessionnelles du «sous-sol» de mon cerveau, qui «ramaient» jusqu’à l’hypnose. Pardon de recourir si fréquemment à des expressions métaphoriques énigmatiques, mais la symptomatologie dépressive dépersonnalisée n’est pas aisée à décrire.
Claude Olievenstein, dans L’homme parano toujours, évoque cette «animalité» inquiétante de la psychose: «C’est peut-être la peur ultime de devenir non-être humain qui bloque le parano dans sa paranoïa, dernière défense devant l’animalité inconnue de la psychose ». Le dépressif – et la dépressive à tendance paranoïaque que je fus – approche cette animalité en pensée. Je visualisais confusément des combats féroces de bêtes rugissantes, qui se seraient mutuellement défigurées, mutilées à coups de griffes et de morsures. Il y a là ce que le sujet dépressif est à même de percevoir comme les signes précurseurs d’un délire. Mais il devine en même temps que ce combat est une «scène» mentale à déchiffrer, un accès anormal à un fragment d’inconscient brut. Je cite à cette occasion un extrait du passage remarquable d’Opération Shylock de Philip Roth que je mentionnais plus haut, où il est question du «moi» atavique qui œuvre sourdement dans la dépression, et qui est soupçonné ici de manière paranoïaque :
«(…) quelque chose de caché, d’obscur, de masqué, de refoulé, ou tout simplement de pas encore éclos en moi avant ma cinquante-quatrième année, mais qui était autant moi et mien que mon écriture, mon enfance ou mes tripes et mes boyaux. J’étais à demi persuadé que, quelle que soit l’idée que je pouvais me faire de moi-même, j’étais aussi ça et que, dans des circonstances suffisamment épouvantables, je pouvais redevenir aussi honteusement dépendant, bêtement déviant, manifestement pitoyable, ouvertement médiocre que ça, cinglé et non perspicace, diabolique et non fiable, incapable de prendre la moindre distance avec moi-même ou de considérer les choses avec calme, sans plus rien de ce courage ordinaire qui rend la vie si merveilleuse – un ça délirant, maniaque, repoussant, angoissé, odieux, halluciné, dont l’existence n’était qu’un long soubresaut.»
Un peu plus haut, Philip Roth écrit avec son éloquence sidérante : « (…) j’étais ravagé par les larmes de cinq décennies de vie, mon être le plus profond livré au regard de tous, sordide et pitoyable». Or, au-delà du sentiment paranoïaque paroxystique dans l’épreuve dépressive, et qui lui survit longtemps, comme l’une de ses formes rémanentes, que dire de cet être profond qui hurle sourdement du fond des tripes dans la dépression ?
Aharon Appelfeld a assuré, pour moi, la transition du silence glaçant de l’univers dépressif vers le silence fécond de la littérature – silence de l’auteur, qui dégage l’oralité de la charge d’avoir à «dire», puisque tout est là, immortalisé dans le livre ; silence du lecteur, qui peut recueillir en lui une parole chargée de sens, que l’auteur lui tend.
Dans ce silence fertile, j’ai appris à me reposer, appris que je pouvais recevoir, d’un frère humain, et non constamment donner sur un mode hémorragique. Dans ce lieu serein où une relation littéraire s’est nouée, j’ai écouté ma propre voix, longtemps étouffée par le tumulte ambiant et la nécessité frénétique d’être « résiliente » à tout prix. Appelfeld est un maître de patience et de sagesse. Il écrit dans L’Histoire d’une vie :
«Avec le même sens que celui des aveugles, j’ai compris que dans ce silence était cachée mon âme et que, si je parvenais à le ressusciter, peut-être que la parole juste me reviendrait.»
La dépression est, au fond, le contraire exact de la catastrophe dont elle revêt l’apparence : elle n’est pas perte de soi mais recherche. J’ai souvent dit, en analyse, que j’étais «sur mes propres traces». La dépression n’est pas un évidement subjectif mais une intégrité narcissique à (re)construire, condition d’un sentiment de plénitude inédit. Comme j’ai pu le dire des troubles du comportement alimentaire dans mon dernier article, ici aussi la psychopathologie est une rupture salutaire. Elle harcèle le sujet pour le mettre sur la piste de ce qui lui appartient ; de cette gamine de 5 ans qui attendait toujours que je vienne la chercher. Philip Roth, encore, l’écrit dans Patrimoine : «On ne doit rien oublier.»
LA RÈGLE DU JEU / MAI 2020 97
