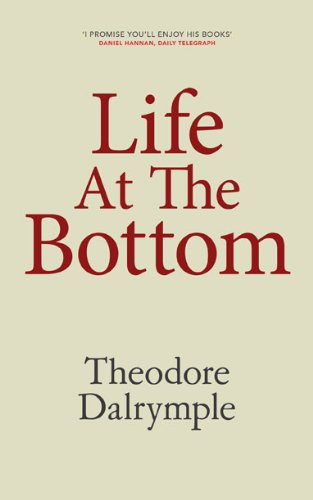Une idée m’avait frappée, chez Winnicott, sur le fait que le thérapeute travaille à partir de sa propre culpabilité. La raison en est, chez Winnicott à la suite de Mélanie Klein, que c’est la culpabilité qu’inspirent au sujet ses propres pensées destructives ou sadiques qui engage à sa suite, normalement, une volonté de réparation, une attitude constructive dans la réalité, et in fine une certaine créativité. C’est une idée qui peut paraître bien curieuse pour quiconque se trouve face à un vide intérieur lorsqu’il essaie d’envisager une telle culpabilité – « mais de quoi serais-je donc coupable ? ».
Claude Olievenstein écrit, dans Il n’y a pas de drogués heureux, que c’est « la montée angoissante des pulsions sadiques » à l’enfance et à l’adolescence qui a peut-être déclenché le désir de devenir psychiatre, là aussi comme nécessité de dévier le cours des pulsions et, si l’on veut, de les « sublimer ».
Ferenczi remarque dans son Journal qu’il est sans doute devenu médecin pour surmonter sa propre misanthropie, ses sentiments d’hostilité et de pessimisme : la formation puis la position du thérapeute consistent – entre autres – à se faire violence et à imposer à ces impulsions intérieures hostiles une torsion dans le sens d’un comportement attentif, empathique, généreux et désintéressé. Ferenczi en particulier est très sensible aux critiques implicites de ses patients – il observe que les critiques ne sont, la plupart du temps, pas formulées expressément par les patients, et qu’il faut les débusquer –, parce qu’il part de l’hypothèse qu’elles sont fondées, et viennent de ce que les patients, hypersensibles à l’analyste, perçoivent des affects d’antipathie chez lui. Au lieu de mettre le tort sur l’aspect paranoïde du patient, Ferenczi a souvent fait le pari – à ses dépens et de façon excessive à mes yeux – que les reproches étaient justifiés et que le fait, pour l’analyste, de les accepter avec humilité en levant ses propres résistances, était l’unique voie pour obtenir la confiance du patient.
Dans une posture plus volontiers freudienne, les insatisfactions sont plutôt « à la charge » du patient : elles relèvent par exemple chez Mélanie Klein de tentatives de sabotage (déprécier ou détruire le travail de l’analyste pour ne pas l’assimiler) ou de logiques transférentielles, mais ne traduisent rien ou peu de l’attitude objective du thérapeute. Deux postures.
Même sans adopter la position ferenczienne, le fait est que, si l’on suit Winnicott, le thérapeute ne peut de toute manière pas travailler sans la conscience de ses propres affects négatifs, destructeurs. En général, toute contribution positive, utile, orientée vers le bien public, ou le bien des autres, ne peut venir que d’une conscience claire de sa propre culpabilité. Sans pulsions de destruction, pas de peur d’avoir détruit ou endommagé ; et sans une telle peur, pas de volonté ni d’action de réparation.
Or je me suis fait dernièrement une réflexion à propos de cette culpabilité, qui n’est pas si aisée à identifier. Je pense en particulier aux sujets avec un vécu d’abus, un passif de maltraitance, qui par la force des choses se construisent avec la conscience d’avoir pâti de la violence des autres. Je ne parlerai pas ici des pervers qui projettent systématiquement le mal sur l’autre et sont inaptes à le percevoir en eux-mêmes, créant de véritables figures expiatoires à l’extérieur pour leurs propres turpitudes ; ces sujets constituent un cas à part, et sont la plupart du temps insensibles au traitement. Pour les victimes d’abus dans l’enfance, comme ça a notamment été mis en évidence par Ferenczi, c’est la culpabilité de l’adulte que l’enfant endosse immédiatement après l’agression, par identification à celui-ci (l’identification étant un mécanisme de survie) :
« Mais cette peur [d’une agression imminente], quand elle atteint son point culminant, les oblige à se soumettre automatiquement à la volonté de l’agresseur, à deviner le moindre de ses désirs, à obéir en s’oubliant complètement, et à s’identifier totalement à l’agresseur. […] le changement significatif, provoqué dans l’esprit de l’enfant par l’identification anxieuse avec le partenaire adulte, est l’introjection du sentiment de culpabilité de l’adulte : le jeu jusqu’à présent anodin apparaît maintenant comme un acte méritant une punition. Si l’enfant se remet d’une telle agression, il en ressent une énorme confusion ; à vrai dire, il est déjà clivé, à la fois innocent et coupable, et sa confiance dans le témoignage de ses propres sens est brisée. » (Confusion de langue entre les adultes et l’enfant, 1932)
On voit bien que l’enfant intègre à sa constitution une sorte de corps étranger : la culpabilité de l’autre, du persécuteur réel, qui n’est pas la sienne. Savoir si le sujet ainsi abusé peut plus tard créer à partir d’une culpabilité qui n’est pas la sienne est une vraie question technique, à laquelle la réponse est vraisemblablement non.
En pratique, la propension d’une ancienne victime à se trouver à nouveau dans une situation de persécution recrée inlassablement une partition dans laquelle le mal est perçu chez l’autre, puis incorporé en soi-même sous la forme de la culpabilité, sans que ne se dégage jamais un espace salutaire pour que le sujet puisse travailler sur ses propres affects destructeurs. Ces derniers sont en quelque sorte éclipsés à côté du mal plus volontiers radicalisé par le comportement du persécuteur. Il y a là un dommage collatéral insidieux, qui est un enjeu technique assez redoutable de la cure. C’est dire que l’agresseur spolie jusqu’à la culpabilité naturelle de l’enfant, liée à son ambivalence fondamentale, en lui imposant la sienne propre (envahissement psychique qui est une continuation du viol).
En lisant Theodore Dalrymple dernièrement, dont la sensibilité est à l’évidence proche de celle d’un Jordan Peterson, je m’aperçois que le caractère polémique de ces penseurs (qu’ils soient psychologues ou psychiatres) vient de ce qu’ils ont remis au cœur de leurs arguments l’irréductibilité, voire le caractère inaliénable, du libre-arbitre et de la responsabilité individuelle, sans quoi l’on retombe dans la mauvaise foi sartrienne – référence explicite chez Dalrymple. Le caractère polémique mais aussi le succès de ces penseurs : leurs patients n’ayant pas le loisir d’être dans une position de « victime », du moins jamais une position totale et définitive, qui serait en même temps une absolution morale et le gage d’une appartenance indiscutable au « camp du bien », ils sont obligés de se tourner vers l’action, mais aussi la prise de conscience de leur « part active » dans leurs situations (pour filer la terminologie sartrienne). Il y a là une dimension fondamentale du travail thérapeutique, aujourd’hui opposée par excellence à l’idéologie de la victimisation comme titre de noblesse et enfermement complaisant dans un infantilisme et une quérulence (revendication) perpétuels.
Cependant, je ne sais pas s’il suffit de marteler aux gens des formules telles que It’s on you! à la manière de Peterson. Je persiste à penser que le travail de déblaiement auquel doit procéder un sujet véritablement traumatisé – qui lui permettra à terme de voir en lui-même des affects négatifs, et de considérer comme sa responsabilité personnelle inaliénable le fait de leur donner une issue favorable dans le réel, une issue constructive et créatrice qui ne soit pas une position de pur dolorisme ou une position masochique –, est un travail de longue haleine qui suppose la capacité du thérapeute à reconnaître et entendre sa parole avec assez de subtilité pour que la reconnaissance n’agisse jamais comme un enfermement ou une rigidification des identifications et des mécanismes défensifs. On parle là d’une compétence technique qui fait du métier de thérapeute un métier qu’on ne peut ni improviser, ni remplacer par du coaching à grand renfort de I don’t who needs to hear this, but it’s OK to…, etc.
J’insiste, en outre, sur le fait qu’il serait illusoire de penser qu’une pure conversion du sadisme, perçu en soi-même de manière angoissante – pour reprendre le mot de Claude Olievenstein –, en masochisme, pourrait être satisfaisante ou suffisante. Il ne s’agirait en l’occurrence que de passer d’un extrême à l’autre, et finalement de maintenir intact le sadisme sous sa forme opposée. Cette structure d’inversion est bien ce qui se cache derrière toute identification durable, c’est-à-dire pathogène, au statut de victime.
Rendre à un patient l’entièreté de sa personnalité, réunir, dans le langage de Ferenczi ou de Mélanie Klein, les différentes parties clivées de son moi à la faveur d’une personnalité mieux intégrée, c’est notamment faire advenir sa propre culpabilité, c’est-à-dire la part sombre de ses propres affects avec laquelle il lui faudra bien se réconcilier pour pouvoir se choisir sur le terrain de la réalité : choisir ce qu’il en fait.