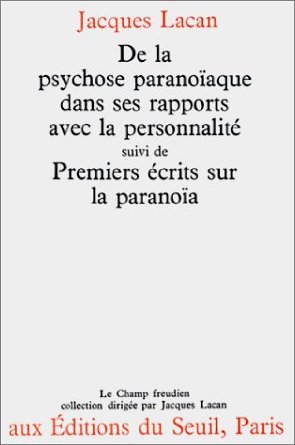Hier un inconnu sur twitter a commenté, en réponse au texte de Lacan que j’avais publié*, qu’il « soupçonnait » l’analyste de n’être pas vraiment endurant à l’angoisse, mais plutôt dans la jouissance du spectacle de l’angoisse du patient. Et c’est marrant parce que ça m’inspire plusieurs choses, ce n’est pas seulement une remarque idiote :
- Les patients redoutent toujours que l’analyste jouisse de leur souffrance, ou de l’expression de leur détresse. Le fait de prêter à l’analyste une pulsion voyeuriste à coloration sadique est très courant, et c’est même constitutif de l’expérience analytique. On pourrait d’ailleurs aller dans ce sens en disant que, généralement, les individus qui deviennent psychanalystes ont « sublimé » leurs propres pulsions, dont, en effet, une forme de voyeurisme dont ils se sentaient coupables. Mais a) que ces individus aient eu une conscience coupable est avant tout le signe de leur éducation morale réussie, puisque les gens qui ne ressentent pas l’angoisse de leurs propres tendances destructives sont plus souvent dénués de scrupules et ignorants d’eux-mêmes que « purs » (et l’on est vraiment ébahi de constater à quel point les gens qui s’accablent de reproches sont les plus éthiques ; les autres préférant ne pas parler d’eux-mêmes) ; b) le fait de devenir psychanalyste a correspondu à un long un parcours préalable – nommément, la cure et l’exploration de soi-même –, qui fait qu’on ne « s’autorise », en droit, à devenir psychanalyste, que le jour où l’on est significativement détaché de toute pulsion de ce genre, qui est apparue vaine. Il ne s’agit pas de « faire de nécessité vertu », ni, en réalité, de « sublimer » : le fond pulsionnel a disparu, ou a été converti à sa source même. La cure ne sert pas à se « discipliner » ; elle sert aussi à changer qualitativement l’ordre des pulsions, et à devenir quelqu’un d’autre. C’est très long, mais c’est réel. Seulement les gens qui pensent avec leurs propres turpitudes – et ils constituent l’immense majorité – partent toujours du principe que les autres les ont aussi, et sont, au mieux, habiles à les dissimuler. C’est le fondement de la paranoïa, et d’une vision acerbe que l’on retrouve, au passage, très souvent sous la plume de Nietzsche.
- Par conséquent, la peur de la jouissance de l’analyste, même si elle est inévitable et compréhensible, procède toujours d’une paranoïa elle-même inscrite dans le transfert. Le patient progresse, entre autres, quand il comprend d’où vient cette paranoïa insistante ; il progresse aussi quand il s’aperçoit – pour autant que l’analyste est compétent et le lui permet – que le cadre de la cure n’est pas dangereux. C’est un enjeu de la cure à part entière, que le patient développe cette confiance ; et c’est très loin de se faire en deux semaines. En réalité, les patients ont nettement moins peur d’être « jugés » s’ils disent x ou y que d’être observés comme des insectes qui seraient tenus, sur un mode presque confessionnel, d’avouer une faute ou ce qui fait la substance même de leurs émotions les plus intimes. C’est la peur d’un « viol psychique », comme l’écrivait Winnicott, qui est la peur que le « noyau du Self » soit endommagé et envahi.
- J’ai pensé à ce titre que le patient est toujours paranoïaque à l’endroit de son analyste – il l’est aussi quand il pense, de façon hystérique, que l’analyste sait quelque chose qu’il lui dissimule, ou qu’il ne livre pas. Mais la paranoïa est également constitutive du travail du psychanalyste : elle est l’un de ses outils. C’est une paranoïa différente, par nature, parce qu’elle ne procède pas d’une projection, d’un élément transférentiel ou d’un complexe persécutoire, mais est une sorte de paranoïa dosée et maîtrisée. Pour comprendre ce que dit le patient, pour détecter des indices et des signes souvent subtils de contenus masqués, inconscients, le psychanalyste doit être paranoïaque. Il doit l’être, non au sens où il se sentirait personnellement attaqué – cette paranoïa, il doit l’avoir exclue de sa propre existence et avoir développé du discernement (celui-ci vient généralement avec la prise de conscience que l’on n’est pas le centre du monde et que l’on n’existe que très exceptionnellement pour les autres, qui sont aux prises avec eux-mêmes 99% du temps) –, mais au sens où il cherche, et où ce savoir suppose toujours de risquer des pistes farfelues et de faire des associations, en partant du principe que le patient dit une chose pour en dire une autre. Chercher cette « autre chose » exige un subtil dosage de paranoïa et d’imagination, et pas seulement une pure rationalité logicienne. C’est une technique et à certains égards c’est un art.
- Pour revenir enfin à cette idée lacanienne d’être « cuirassé » contre l’angoisse : c’est nécessaire dans la mesure où ce que le psychanalyste entend, il ne peut l’entendre qu’en restant « vivant » (Winnicott), c’est-à-dire émotionnellement relié au patient, et à lui-même. L’analyste n’est pas magiquement « coupé » des sources irréductibles de souffrance humaine auxquelles ses patients sont confrontés. Il ne s’est pas exclu de l’humanité souffrante avec un ticket pour le paradis. C’est le contraire : il a appris à souffrir et à abattre tout ce qui pourrait relever d’une organisation défensive maniaque, obsessionnelle ou psychotique contre la souffrance. Il n’est donc pas extérieur ; et s’il l’est, il devient mauvais. Thomas Ogden souligne avec justesse, dans la continuité de Winnicott, que le psychanalyste doit s’efforcer constamment de se rappeler et d’éprouver « ce que ça fait ». Sans ça, il ne peut apporter aucune aide substantielle. Mais s’il reste éveillé à la douleur et à la connaissance de ses propres vécus d’angoisse et d’effondrement, c’est avec une solidité et une santé mentale qu’il a péniblement acquises, autrement dit avec cette « cuirasse » qu’évoque Lacan. Un psychanalyste, ce n’est pas quelqu’un qui vit désormais une vie de délices et de facilités, mais quelqu’un qui « tient » (sans recourir à des défenses pathologiques). Et sa faculté de tenir, avec des ressources qui ne sont pas celles du vaste champ de la maladie mentale et des addictions, est l’autre condition à laquelle il peut apporter une aide.
Si on ne prend pas cela au sérieux, on ne prend pas au sérieux l’idée de la cure elle-même – le fait qu’il puisse en exister un produit – ; on pense que l’analyste est un malade mental qui prend en charge d’autres malades mentaux.
* Extrait de la conférence de presse de Jacques Lacan au Centre culturel français, Rome, 29 octobre 1974.
La différence entre ce qui marche et ce qui ne marche
pas, c’est que la première chose, c’est le monde, le
monde va, il tourne rond, c’est sa fonction de monde ;
pour s’apercevoir qu’il n’y a pas de monde, à savoir
qu’il y a des choses que seuls les imbéciles croient
être dans le monde, il suffit de remarquer qu’il y a des
choses qui font que le monde est immonde, si je puis
m’exprimer ainsi ; c’est de ça que s’occupent les
analystes ; de sorte que, contrairement à ce qu’on
croit, ils sont beaucoup plus affrontés au réel même
que les savants ; ils ne s’occupent que de ça. Et
comme le réel, c’est ce qui ne marche pas, ils sont en
plus forcés de le subir, c’est-à-dire forcés tout le temps
de tendre le dos. Il faut pour ça qu’ils soient
vachement cuirassés contre l’angoisse.